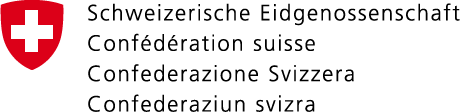Situation migratoire en Italie
En 2023, le nombre de migrants franchissant la mer Méditerranée pour se rendre en Italie a augmenté, principalement sur la route méditerranéenne centrale (Tunisie, Libye). D'autres personnes ont emprunté la route méditerranéenne orientale (Turquie) et la route des Balkans (Slovénie). Entre janvier et juillet 2023, plus de 89 000 migrants ont débarqué sur les côtes de la péninsule, soit une hausse de 115 % par rapport à la même période de 2022. Sur l'ensemble des migrants entrés en Italie, 12 % étaient des mineurs non accompagnés.
Les forces de police aux frontières ont besoin d'équipes de soutien qualifiées capables de communiquer rapidement avec les migrants et de les informer sur les procédures tout en garantissant la prise en compte et le respect de leurs droits et besoins de protection. Ces dernières années, la présence de personnel qualifié de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a contribué à la bonne gestion des frontières et permis de favoriser le dialogue avec les migrants et les autorités des pays voisins.
Objectifs du projet
Le projet vise, d'une part, à améliorer et à accélérer l'identification et les procédures d'asile en Italie et, d'autre part, à garantir que les migrants reçoivent un traitement approprié, avec une attention particulière pour les personnes vulnérables, telles que les mineurs non accompagnés et les victimes de la traite des êtres humains.